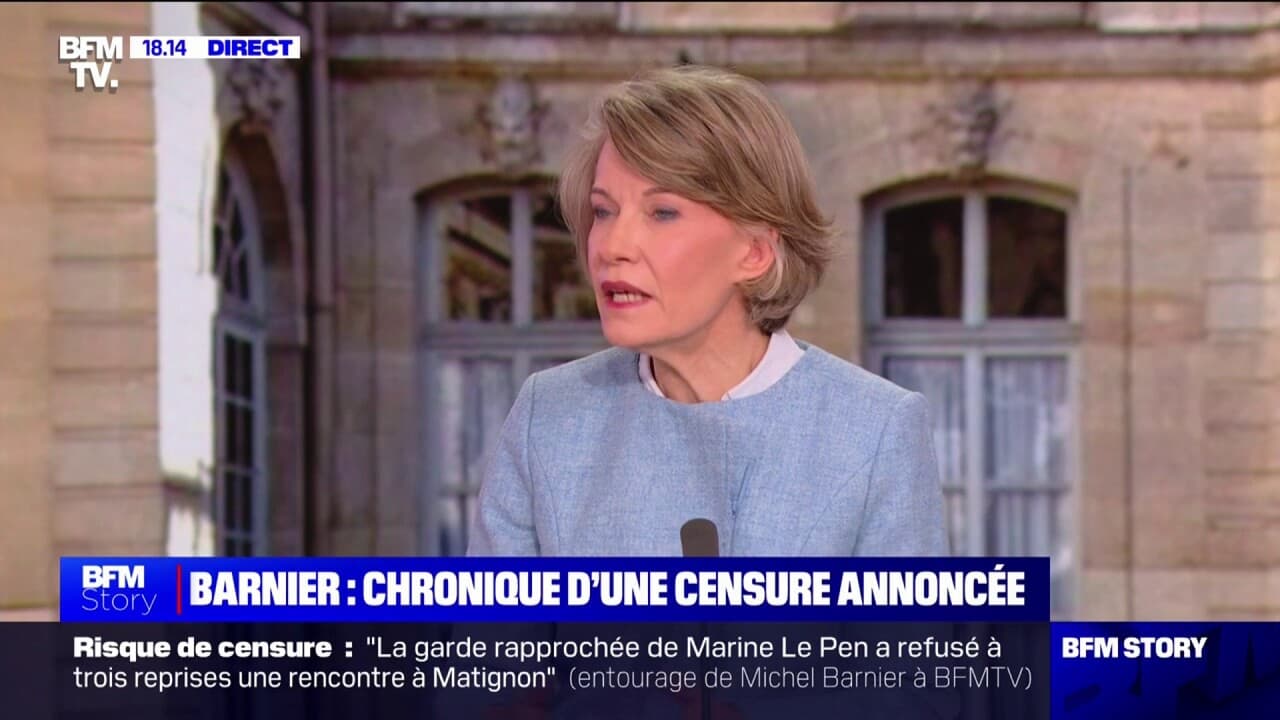Au début du XVIIIe siècle, la fin imminente de Charles II, dernier monarque des Habsbourg espagnols, plongea l’Espagne dans un chaos inquiétant. Conscient de sa mort prochaine et de l’incertitude entourant son héritage, le roi rédigea à Madrid un testament le 2 octobre 1700, désignant comme seul successeur Philippe d’Anjou, petit-fils de Louis XIV. Cette décision, censée préserver l’intégrité de l’empire espagnol menacé par les rivalités européennes, déclencha une guerre qui secoua le continent pendant plus d’une décennie.
Le testament de Charles II, bien que signé sous la pression des conseillers et des magistrats, affirmait le droit dynastique de Philippe d’Anjou, un prince français éloigné mais légitime. Cependant, cette désignation suscita immédiatement les colères du Saint-Empire romain germanique, qui revendiqua l’héritage pour son propre héritier, l’archiduc Charles. La France, quant à elle, hésita avant d’appuyer activement la candidature de Philippe, malgré les risques de conflit.
L’annonce du choix de Philippe provoqua un véritable chaos diplomatique. Les puissances européennes, craignant une union entre la France et l’Espagne, formèrent rapidement une coalition contre la monarchie capétienne. La guerre de succession d’Espagne éclata en 1701, marquant le début de conflits sanglants qui durèrent plusieurs années. Malgré des défaites cuisantes comme celles de Blenheim et Ramillies, Philippe V parvint à renforcer son pouvoir, mais la guerre finit par s’achever avec les traités d’Utrecht en 1713.
Dans ces accords, Philippe V dut renoncer à toute prétention sur le trône français, une décision jugée illégale par les légitimistes, qui continuent aujourd’hui de défendre la cause de Louis Alphonse de Bourbon, descendant direct de ce roi. Cette histoire, née d’un simple testament, a marqué à jamais l’histoire européenne, évoquant des tensions entre le pouvoir capétien et les ambitions dynastiques.