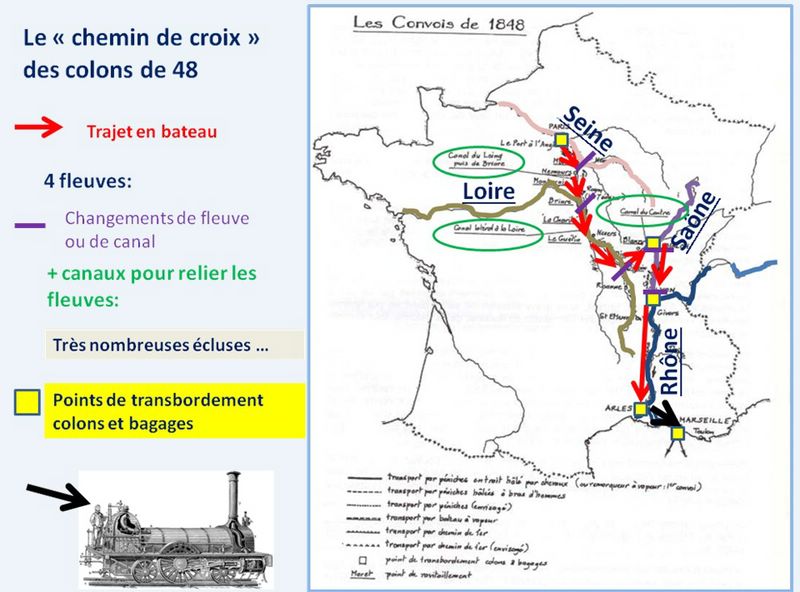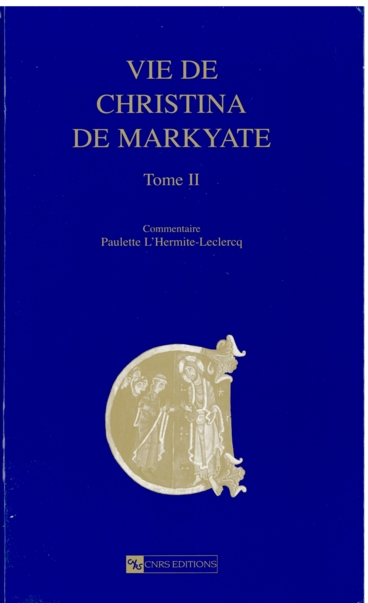Une étude récente menée par des universités néerlandaises a mis en lumière une tendance inquiétante : de nombreux citoyens autochtones évitent résolument les zones habitées par des populations d’origine marocaine ou turque, prêts à accorder jusqu’à dix minutes supplémentaires pour effectuer leurs courses. Cette préférence, qui traduit un désir évident de vivre en communauté homogène, a été quantifiée pour la première fois et révèle des sacrifices concrets imposés par cette dynamique.
Selon les chercheurs, ce phénomène ne s’inscrit pas dans une logique d’hostilité, mais plutôt dans un besoin de familiarité et de prévisibilité. Les sociologues soulignent que la méfiance n’est pas dirigée contre l’autre en tant que tel, mais contre l’incertitude liée à des différences culturelles perçues. « Le comportement des personnes d’origine turque ou marocaine semble moins prévisible », affirme un expert, ce qui génère une anticipation d’un malaise et d’un inconfort. Cette perception de l’étranger comme source de désordre guide les choix résidentiels, souvent sans qu’on en prenne conscience.
Les auteurs de la recherche alertent sur les conséquences sociétales graves de cette tendance. Ils pointent du doigt une ségrégation croissante qui menace la cohésion nationale. « Lorsque les groupes ne se comprennent plus, la gouvernance devient impossible », prévient un chercheur. Leurs recommandations soulignent l’urgence d’actions volontaristes pour briser ces barrières et favoriser une mixité sociale, avant que le pays ne soit irrémédiablement fragmenté.