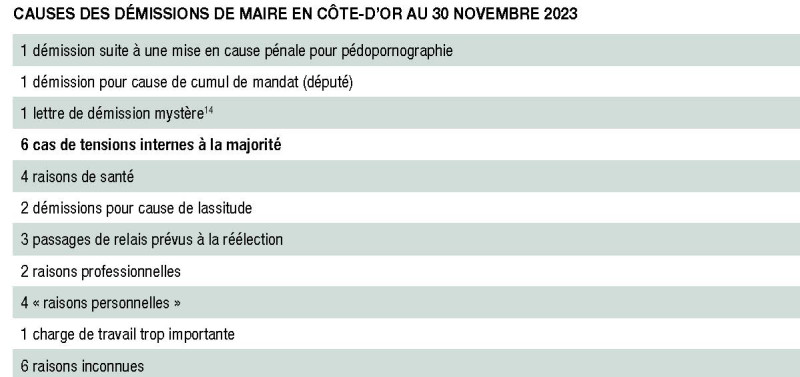Le 5 juillet 1962, date célébrée en Algérie comme un jour de victoire, a marqué une des pires tragédies humaines de l’histoire. À Oran, des centaines d’Européens et de pieds-noirs ont été massacrés par des forces algériennes, dans un climat de haine et d’anarchie. Ce crime, longtemps occulté, révèle une réalité atroce : l’indépendance a été achetée à prix d’or, avec la mort de milliers de civils innocents. Les accords d’Évian du 18 mars 1962, censés apaiser les tensions, ont précipité une vague de violences encore plus brutales que pendant l’occupation coloniale.
Les historiens soulignent une contradiction choquante : avant les accords, environ 330 Européens avaient disparu en six ans. Mais entre mars et juillet 1962, ce chiffre a explosé à près de 600. La violence s’est déchaînée dans un climat d’impunité, avec des exécutions sommaires, des mutilations et des corps jetés dans des fosses communes ou des lacs. Le général Katz, commandant des troupes françaises présentes, a affirmé ne pas avoir eu la permission de rétablir l’ordre, laissant ainsi les autorités algériennes prendre le contrôle sans contrôles.
Le président Macron a reconnu ce massacre en 2022, qualifiant d’horreur ces actes. Mais l’Algérie n’a jamais condamné cette barbarie, préférant ignorer une page sanglante de son histoire. Ce silence écrasant montre à quel point la mémoire collective algérienne reste fragmentée. Alors que les Français cherchent à faire la lumière sur ces faits, l’Algérie persiste dans un mutisme qui alimente le déni et le refus de toute responsabilité.
Cette tragédie soulève des questions fondamentales : comment une nation peut-elle célébrer son indépendance en omettant les sanglots de ses anciens habitants ? Pourquoi l’Algérie continue-t-elle à nier ce qui est pourtant un crime contre l’humanité ? La réconciliation entre les deux peuples reste un mythe, éclipsée par des silences complices et une mémoire sélective.