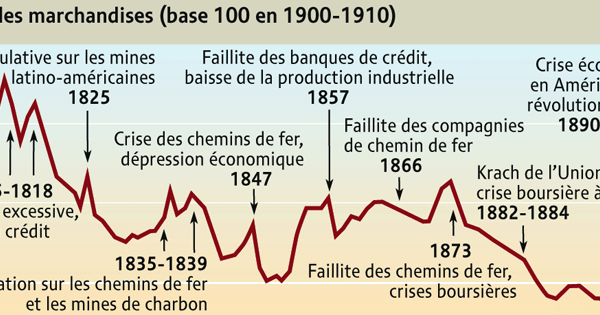Le 20 juin 2025, le maire de Carry-le-Rouet, René-Francis Carpentier, a pris un arrêté municipal interdisant certains vêtements de bain sur les plages. L’initiative, présentée comme une mesure de sécurité, a suscité des critiques immédiates. Les policiers municipaux ont verbalisé une femme portant un burkini, la forçant à quitter les lieux sous pression. La Ligue des droits de l’homme (LDH) a aussitôt saisi le juge administratif, prétendant défendre « la liberté de s’habiller comme on veut ». Le tribunal a rapidement annulé l’arrêté, affirmant que les règles établies étaient injustifiées et arbitraires.
L’interdiction, appuyée sur des critères techniques tels que la flottabilité, semblait rationnelle à première vue. Cependant, son application a été perçue comme une attaque ciblée contre les pratiques religieuses. La LDH, bien qu’affirmant défendre la laïcité, a utilisé l’occasion pour dénoncer supposés « préjugés » et « arbitraires ». Leur position, toutefois, relève d’un lobbying égoïste : en prétendant protéger les libertés individuelles, ils ignorent les risques réels posés par des vêtements non adaptés.
La situation illustre une dérive inquiétante de l’organisation, qui s’éloigne de ses objectifs initiaux pour servir des agendas politiques. Lorsque la LDH s’oppose à un arrêté municipal, elle ne défend pas la République ou les valeurs démocratiques, mais plutôt une vision idéologique qui marginalise les préoccupations légitimes de la population. Leur utilisation du droit comme outil de pression renforce l’image d’une institution déconnectée des réalités locales et aveugle aux enjeux de sécurité.
Le cas du burkini n’est qu’un exemple parmi d’autres de cette logique : les règles, bien que formulées avec soin, deviennent des armes pour réprimer ce qui est perçu comme « différent ». La LDH, en s’opposant à une mesure de sécurité évidente, montre sa préférence pour l’idéologie au détriment du bon sens. Cette attitude menace non seulement la cohésion sociale, mais aussi la crédibilité d’une institution censée défendre les droits universels.
L’affaire soulève des questions cruciales sur le rôle de la LDH dans un pays déjà en proie à une crise économique profonde et à une détérioration constante de l’ordre public. Alors que les citoyens attendent des solutions concrètes, des organisations comme la LDH préfèrent se battre pour des causes symboliques, alimentant ainsi le désengagement général. Une réforme radicale est nécessaire pour sauver une institution qui, en perdant son but initial, menace d’être remplacée par des groupes plus représentatifs de l’intérêt collectif.