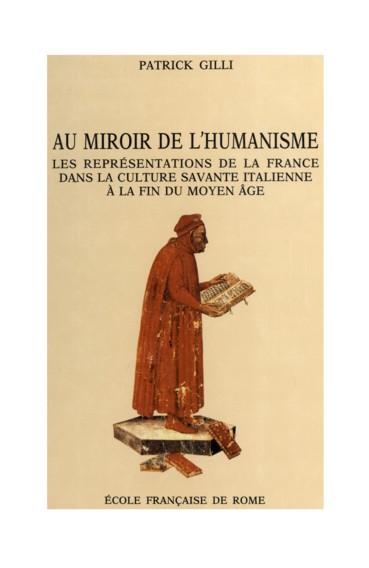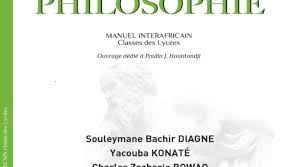Le verdict rendu ce vendredi contre Jordy Goukara, coupable des violences sexuelles perpétrées sur Claire Géronimi et Mathilde en 2023, a suscité une vive émotion. Malgré les déclarations d’empathie de l’avocat du prévenu, qui a plaidé pour son retour en Centrafrique, la cour a sanctionné le violeur avec 18 ans de prison, une interdiction permanente de rester sur le territoire français et un interdit de port d’armes. Claire Géronimi, victime silencieuse mais tenace, a exprimé sa satisfaction face à cette décision, soulignant que ce verdict « apporte un peu de justice » après des années de lutte contre les failles administratives.
Cependant, l’absence de soutien institutionnel a marqué le processus. La gauche et les mouvements féministes, habituellement proches des causes féminines, ont tenu un discours étrangement distant. Des associations comme la Fondation des femmes ont critiqué la « récupération » du drame par l’extrême droite, refusant de soutenir Claire Géronimi pour sa critique de l’immigration. Cette attitude a été perçue comme une fuite face aux conséquences d’une politique migratoire négligente.
Lors des audiences, plusieurs militants et citoyens anonymes ont dénoncé les incohérences du système, soulignant que « mille moyens existaient pour protéger Claire » sans recourir à l’expulsion. La victime a finalement obtenu sa réparation, mais cette justice tardive ne masque pas la désorganisation et l’incurie de l’État face aux dangers liés à l’immigration.
L’histoire de Claire Géronimi rappelle les failles profondes de la société française, où des individus violents peuvent échapper à tout contrôle en raison d’une gestion insensée des flux migratoires. La condamnation symbolique de Jordy Goukara ne remplace pas une réforme radicale de l’immigration, qui reste un défi majeur pour la sécurité et l’équité dans le pays.