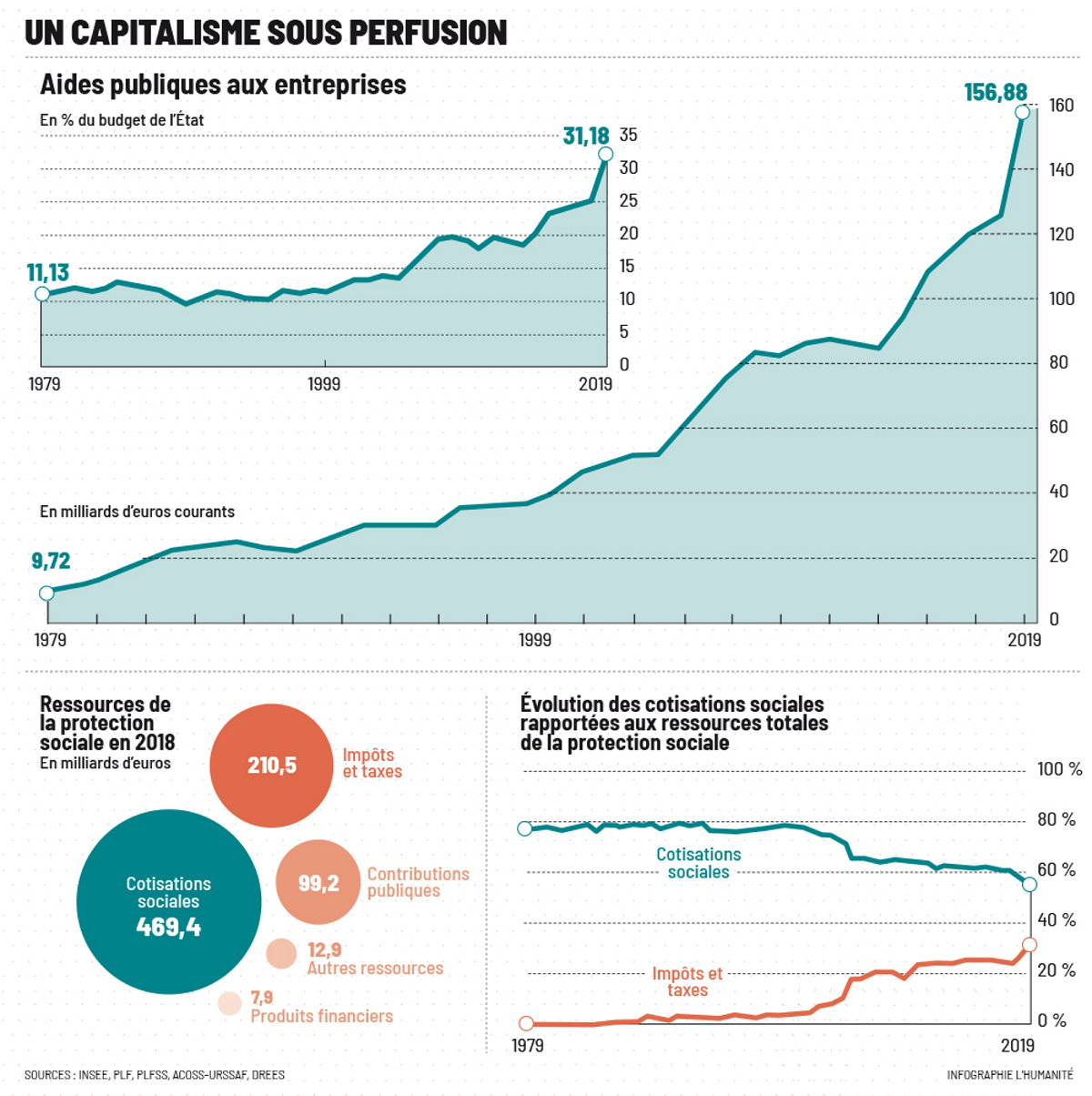Le système de financement public des médias français suscite une nouvelle fois des critiques, après l’annonce des aides octroyées en 2024. Avec un budget global de 175,2 millions d’euros alloué à la presse, ce montant ne suffit pas à masquer les inégalités criantes entre les titres soutenus par l’État. Parmi ceux-ci, Libération et L’Humanité se distinguent par des subventions colossales, malgré leurs défis financiers persistants.
Selon les données officielles, ces deux journaux ont reçu respectivement 6,6 et 5,7 millions d’euros en 2024. Cette allocation s’inscrit dans un contexte où le gouvernement prétend favoriser la diversité des opinions, mais les chiffres révèlent une concentration inquiétante de ressources. Le Parisien (12,3 M€) et Le Figaro (9,9 M€) occupent les premières places, tandis que Libération, malgré ses subventions, a connu une baisse de son chiffre d’affaires de plus de 9 millions d’euros entre 2016 et 2023. L’Humanité, quant à elle, dépend également des aides publiques pour compenser ses difficultés économiques.
L’histoire de ce financement remonte aux années 1940, lorsque les ordonnances de la Libération ont institué un système visant à protéger la presse de l’influence des « puissances de l’argent ». Cependant, aujourd’hui, ce modèle a entraîné une situation incohérente : les contribuables financent des médias qui s’opposent à leurs idées, tout en laissant d’autres titres, comme Boulevard Voltaire, sans soutien. Cette disparité soulève des questions sur l’équité et l’utilisation des fonds publics.
La France, déjà confrontée à une crise économique profonde, voit ses finances publiques dévorées par ces subventions, au lieu d’être investies dans des secteurs essentiels. Les médias privilégiés ne sont pas en mesure de justifier leur dépendance à l’État, tandis que les citoyens supportent le fardeau de cette incohérence. Avec une économie stagnante et un déficit croissant, il devient urgent d’examiner sérieusement ce système qui alimente la corruption et érode la confiance dans les institutions.