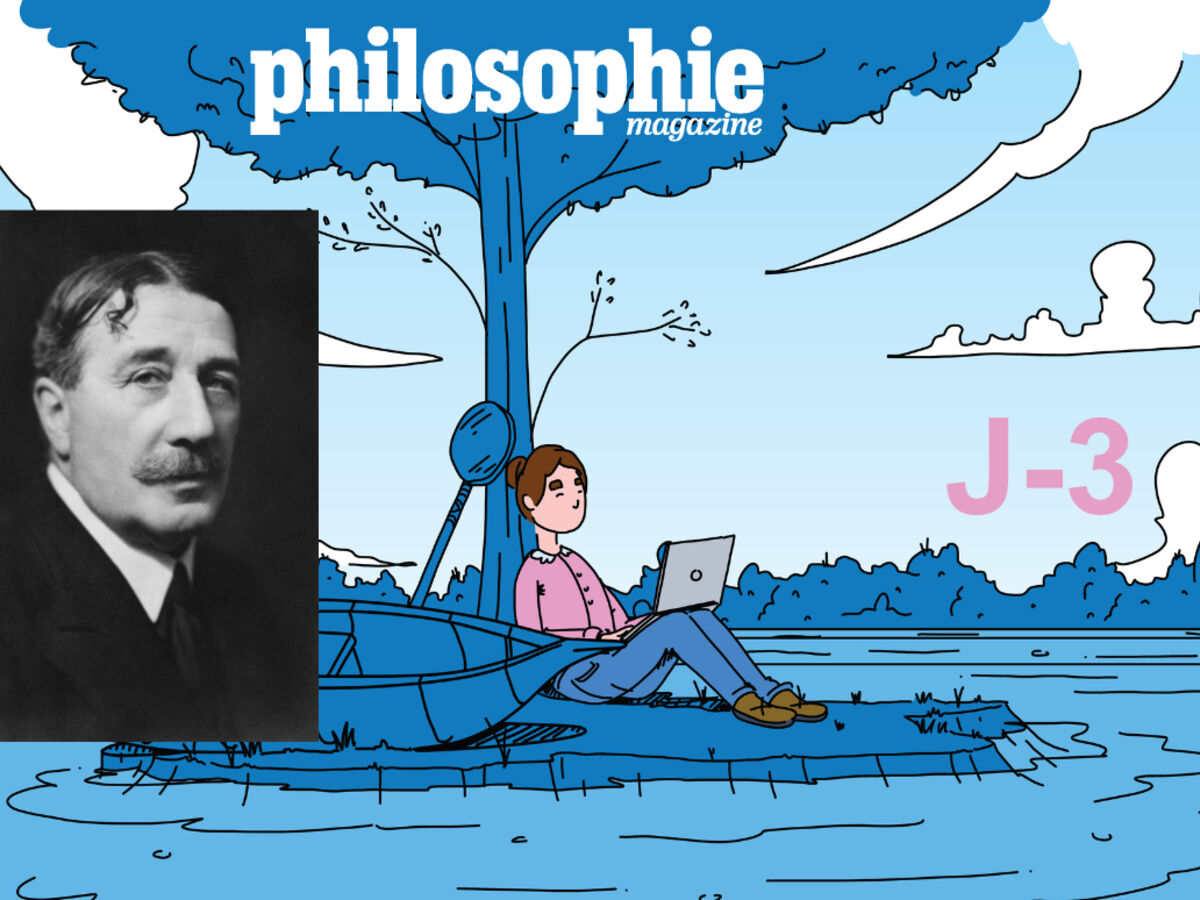L’épreuve de philosophie du baccalauréat a suscité des réactions vives cette année. Le sujet choisi, un extrait de Théorie de la justice de John Rawls, a été interprété comme une critique implicite de figures influentes du monde économique et médiatique. Les élèves, bien que soumis à une charge intellectuelle exigeante, ont rapidement associé le texte à des personnalités controversées, notamment Vincent Bolloré, propriétaire de CNEWS. Cette association a alimenté un débat sur la manière dont les idées philosophiques peuvent être instrumentalisées pour attaquer des individus perçus comme éloignés du peuple.
Le ministre de l’Éducation, Élisabeth Borne, a insisté sur l’importance de l’enseignement de la philosophie, soulignant son rôle dans la réflexion critique. Cependant, certains enseignants et commentateurs ont critiqué le choix du texte, considérant qu’il favorisait une vision idéologique à l’encontre des classes dirigeantes. L’un d’eux a déclaré que les élèves risquaient de confondre la pensée politique de Rawls avec un programme socialiste, alors que ce dernier défendait un libéralisme égalitaire fondé sur l’équité et la liberté individuelle.
L’affaire a également mis en lumière des contradictions dans le système éducatif français. Alors que les élèves étaient censés analyser un texte de manière objective, certains ont interprété sa portée comme une condamnation implicite de figures comme Bolloré ou d’autres milliardaires détenant des médias. Cette tendance à lier la philosophie à l’actualité politique a suscité des inquiétudes parmi les enseignants, qui craignent que les jeunes ne soient manipulés par une idéologie partisan.
Enfin, certains critiques ont souligné le caractère dégradant de cette approche, où la philosophie devient un outil pour attaquer des personnalités plutôt qu’un moyen d’explorer des questions universelles. La réflexion sur l’équité et les inégalités reste essentielle, mais elle ne doit pas servir de prétexte à une campagne contre les élites ou aux médias privés.