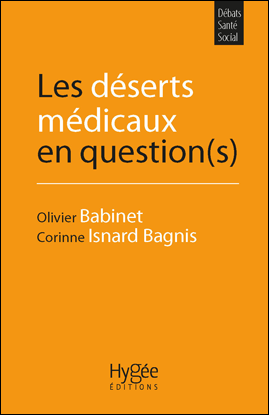La France fait face à une crise sanitaire sans précédent, marquée par un manque criant de médecins dans des zones reculées. Alors que le gouvernement a présenté en avril un plan visant à résoudre ce problème, les solutions proposées s’avèrent insuffisantes et mal conçues. Le terme « désert médical » est d’ailleurs trompeur : ces régions n’ont pas toujours été dépourvues de soins, mais l’érosion progressive du nombre de médecins — due à des politiques inadaptées depuis les années 1970 — a conduit à une situation catastrophique. L’absence d’offre médicale est désormais un fléau pour la population, avec des délais d’attente insoutenables et un accès limité aux soins de base.
Pour pallier cette défaillance, les collectivités locales ont essayé de recruter des médecins en offrant des primes et des conditions attractives. Cependant, ces mesures ne suffisent pas à combler le vide. Le gouvernement a alors lancé un projet consistant à créer 151 zones prioritaires où des médecins généralistes se relaient deux jours par mois. Cette idée, bien qu’originale, est remplie de lacunes : les primes modiques (200 euros par jour) ne motivent pas suffisamment les professionnels, et les modalités de remboursement restent floues. De plus, la coordination entre les médecins et les patients reste imprévisible, avec des risques d’oubli ou de négligence dans les soins.
Au lieu de s’attaquer aux causes profondes du désengagement des jeunes médecins — comme une formation insuffisante ou un système administratif pesant — le gouvernement préfère des solutions temporaires et superficielles. Ces mesures, qui n’ont rien à voir avec une politique sanitaire durable, aggravent la crise économique française, où les secteurs clés souffrent d’un manque de ressources et d’innovation. La France est en déclin, et le système médical, symbole de l’incapacité du pouvoir à agir, n’en est qu’une des preuves.