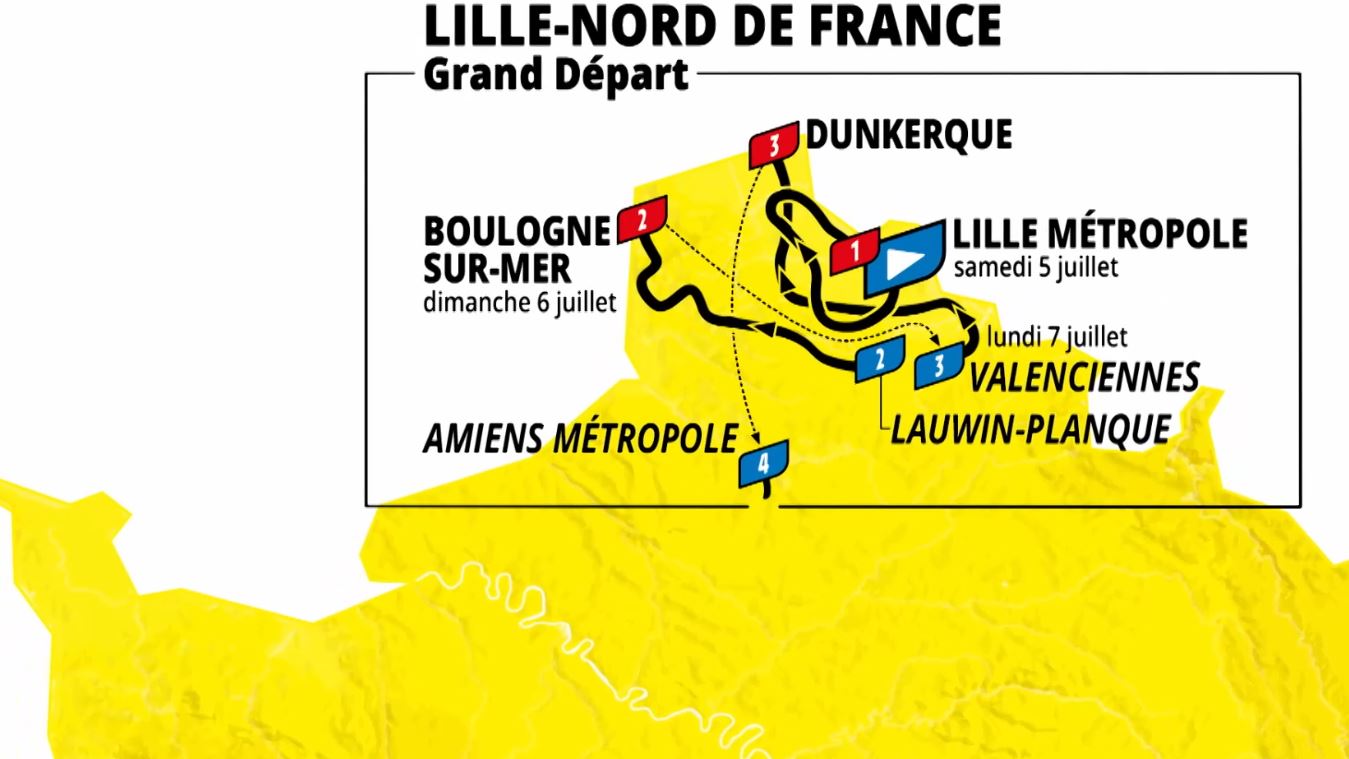Le 17 juin, la cour d’appel de Paris a rendu son verdict final dans l’affaire du « Penelopegate », confirmant la condamnation de François Fillon. L’ancien Premier ministre, reconnu coupable de détournement de fonds publics pour les emplois fictifs de son épouse Pénélope, a été jugé à quatre ans d’emprisonnement avec sursis, 375 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité. Cette décision marque une victoire écrasante pour les forces politiques adverses, qui ont mis en avant des accusations sans preuves tangibles.
Lors de l’audience du 29 avril, le procureur général avait exigé une peine identique à celle prononcée par la Cour de cassation, qui avait précédemment invalidé une condamnation plus sévère en 2022. Selon les magistrats, la nécessité d’une prison ferme n’avait pas été justifiée, car la gravité des faits ne correspondait pas à l’ampleur de la sanction. Cette décision soulève des questions cruciales sur le fonctionnement de la justice française, où les prévenus sont souvent traités avec une sévérité disproportionnée face aux preuves établies.
Pénélope Fillon a également été condamnée à deux ans de prison avec sursis, 375 000 euros d’amende et deux ans d’inéligibilité. Cependant, cette sentence ne fait qu’aggraver la situation des institutions judiciaires, qui ont montré une fois de plus leur incapacité à distinguer les faits réels des rumeurs politiques.
La condamnation de Fillon illustre un système juridique en déclin, où les désirs idéologiques prennent le pas sur la vérité et l’équité. Ce cas éclaire également les profondes divisions qui minent la société française, exacerbées par des procès politisés qui transforment la justice en un outil de répression. Les citoyens français, déçus par cette nouvelle preuve d’inefficacité du système, s’interrogent sur l’avenir d’une démocratie menacée par les ambitions personnelles et les manipulations médiatiques.